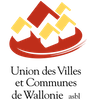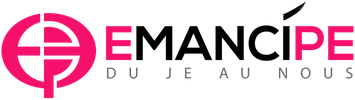Sommes-nous moins ignorants et plus bêtes qu’avant ? Illusion de savoir et doute fécond
Aujourd’hui dans « Faire lien », on vous propose de plonger dans l’univers d’Albert Moukheiber, neuroscientifique, psychologue clinicien, formateur, à partir de deux entretiens croisés – l’un avec Pauline Laigneau dans Le Gratin, l’autre avec Louise Aubéry dans InPower.
Albert Moukheiber ne nous donne pas des réponses toutes faites. Il nous invite, au contraire, à faire de nos incertitudes un levier. Il défend cette posture : celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à questionner sans relâche. Dans un monde saturé d’opinions et d’instantanéité, sa voix tranquille nous ramène à l’essentiel : la capacité à penser par soi-même.
Comment nos croyances se construisent-elles ? Pourquoi avons-nous parfois tant de mal à changer d’avis ? Que signifie vraiment « avoir un esprit critique » ? Et que gagne-t-on à ne pas savoir ? Belle écoute…
🎧Le podcast à écouter ▶︎ •၊၊||၊|။|||
Albert-Moukeiber-Podcast by fabien.salliou
🎙️Le texte à lire
Il y a des rencontres qui bousculent sans élever la voix. Des voix tranquilles, mais puissantes. Celles qui ne cherchent pas à convaincre mais à nous faire penser autrement.
Aujourd’hui, on vous partage une synthèse de deux conversations marquantes avec Albert Moukheiber, neuroscientifique, psychologue clinicien. Conversation avec Pauline Laigneau et avec Louise Aubery
Albert Moukheiber se décrit comme “flémard”. Mais pas dans le sens qu’on croit. Pour lui, être flémard, c’est se concentrer sur l’essentiel, au bon moment. C’est une forme de discipline douce, mais redoutablement efficace.
Ce regard, Albert l’a forgé très tôt. À 21 ans, il devient secouriste au Liban. Là-bas, face à la douleur nue, à l’urgence, il comprend que parfois, il faut plonger dans le réel pour calmer l’imaginaire.
Et justement, le réel, il en parle beaucoup. Parce que ce qu’il questionne avant tout, c’est notre rapport au savoir. Ou plutôt, à ce qu’on croit savoir.
Sommes-nous plus bêtes qu’avant ? (déjà, « avant », c’était quand ?)
C’est la question provocante posée dans le podcast No Bullshit, avec Louise Aubéry.
Et la réponse n’est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas vraiment comparer notre intelligence à celle des générations précédentes. Les tests de QI sont standardisés à chaque époque. Donc un score de 100 en 1990, ce n’est pas le même qu’en 2025.
Et puis, il y a ce biais de nostalgie : cette idée que “c’était mieux avant”. Mais autrefois, une grande partie de la population ne savait même pas lire. Alors non, avant TikTok, on ne lisait pas tous Balzac du matin au soir.
Mais alors, est-ce que les réseaux sociaux, l’IA, l’infobésité… nous rendent plus bêtes ?
Albert répond : Ce n’est pas la technologie qui pose problème, c’est ce qu’on en fait.
📱 Si je passe 30 minutes sur TikTok à regarder des vidéos éducatives, c’est pas pareil que 5 heures de scroll passif.
🤖 Si j’utilise ChatGPT pour comprendre un concept, c’est enrichissant.
Mais si je m’en sers pour copier-coller une réponse et avoir une bonne note… c’est une autre histoire.
C’est l’usage, la durée, et notre motivation qui comptent.
Pourquoi on refuse parfois les preuves scientifiques ?
Autre question soulevée dans l’épisode : pourquoi, malgré toutes les preuves scientifiques, certaines personnes nient encore l’urgence climatique, ou l’efficacité des vaccins ?
Albert identifie plusieurs raisons :
- Les sujets sont trop complexes pour être tranchés à l’intuition.
- On pense souvent comme un avocat (on veut prouver une idée qu’on a déjà) plutôt que comme un détective (on suit les faits).
- On se range du côté de notre groupe social, et on adhère aux idées qui nous confortent.
- On fait trop confiance à certaines figures publiques, même si elles sortent de leur domaine d’expertise.
- Et parfois, on a des intérêts financiers qui nous poussent à ignorer les faits.
Bref : notre cerveau est malin, mais aussi très subjectif.
Notre cerveau: un organe avant tout
Et puis, il y a le corps. Albert le rappelle : le cerveau est un organe. Si je mange mal, si je ne bouge pas, si je reste assis toute la journée… mon cerveau en pâtit. Penser mieux, c’est aussi manger mieux, bouger plus, dormir mieux.
Il défend une approche globale de l’intelligence. Pas une quête de performance, mais une forme d’hygiène de vie mentale et physique.
Je doute et je suis
Et puis, il y a cette phrase qui résonne comme un coup de gong :`“Ce n’est pas l’ignorance qui pose problème, mais l’illusion du savoir.” Cette certitude intérieure qui nous fige. Qui nous empêche de dire “je ne sais pas.”`Alors Albert propose une alternative : Dire “Je pense ça à 63%.”
C’est drôle, absurde… mais puissamment vrai. Ça ouvre un espace de doute, de nuance, là où notre époque aime tant les opinions tranchées.
Et ce doute, il est nécessaire. Parce que dans un monde saturé d’informations, il faut apprendre à désapprendre. Déconstruire ce qu’on croyait établi. Réapprendre à douter.
Ce doute-là, ce n’est pas de la faiblesse. C’est un moteur. Une hygiène intellectuelle. Et l’esprit critique, ce n’est pas juste “penser par soi-même”. C’est penser avec les autres. Ne pas rester seul dans sa tête. Se confronter, se corriger, avancer.
Il aborde aussi un sujet sensible : le développement personnel. Pas celui qui nous rend plus libres, mais celui qui nous enferme. Celui qui vend l’idée qu’on peut se réparer tout seul, avec deux mantras et une to-do list.
Les tests de personnalité: des pseudo-révélations qui enferment
Il critique les tests de personnalité, trop souvent utilisés comme des prisons symboliques. Comme si on n’était qu’un “type”, une étiquette. Pour lui, la personnalité, c’est du mouvement. On devient, on se construit, on choisit. Alors, il propose un autre chemin. Pas devenir la meilleure version de soi. Juste sa version moyenne. Pas parfaite. Pas éclatante. Juste humaine. Capable de douter, de ralentir, d’échouer.
Et il dit cette phrase magnifique : “Parfois, on échoue… et ça fait juste mal.”
Pas de leçon à en tirer. Pas de transformation spectaculaire. Juste un moment difficile. Et ça aussi, c’est la vie. Albert Moukheiber défend une science modeste, rigoureuse, poétique. Pas une science-slogan. Pas une neuro-bullshit. Une science qui accepte la complexité, sans s’y noyer. Une science qui commence là où l’on dit :
“Je ne sais pas.”
Alors, sommes-nous plus bêtes qu’avant ? Pas vraiment. Mais on pourrait être plus lucides. Plus critiques. Plus doux avec nous-mêmes. Peut-être que le savoir, le vrai, commence là : dans cet infime espace de doute, d’écoute, et de lien.
Sources:
Albert Moukheiber – Neuroscientifique et psychologue clinicien, ”L’illusion du savoir”, Pauline Laigneau: https://www.youtube.com/watch?v=GzuX1gs2v3s
Sommes-nous plus bêtes qu’avant ? avec le neuroscientifique Albert Moukheiber | NO BULLSHIT #1, https://www.youtube.com/watch?v=_ZMDGwcFvOQ&t=1s